|
|
| 10 : 10 : 12 |

Le ras-le-bol des savants et des créateurs |
Nous
relayons ci-dessous l'Appel pour la défense des savoirs (et des savoir-faire).
Vous pouvez le soutenir en faisant circuler les petits signes fournis par ce
site lorsqu'on clique sur le dessin qui clignote : les envoyer par le Net, en
faire des badges, autocollants, images monumentales, affiches, installations
artistiques ou interventions dans l'espace public... A Saint-Nazaire ou à Hong Kong. Il est temps d'enrichir nos débats trop hexagonaux, de rester dans une logique de transformations, de
rééquilibrer la visibilité sociale et de repenser nos repères et nos valeurs.
Appel
à la Résistance des savoirs
En regardant (en 2012) le sommaire de la nouvelle
émission culturelle de France 2 intitulée « Grand public », nous
pouvons comprendre deux phénomènes lourds actuels qui consistent dans la
déculturation et l’acculturation. Ce sommaire en effet, pour une émission de
deuxième partie de soirée sur le service public, n’annonçait que
des « people » passant en boucle sur toutes les autres chaînes.
La commercialisation de vecteurs liée à leur multiplication en nombre a abouti
à une offre en fait de plus en plus réduite : plus il y a de chaînes, plus
elles se singent. La quantité n’est pas la diversité. Faut-il pour
autant tomber l’aigreur et se replier sur quelques casemates de bien-pensance
où « nous sommes entre nous » ? Sûrement pas.
La dévalorisation, la déqualification touche certes
tous les milieux. Mais la résistance est aussi le fait de tous les milieux.
Voyons d’abord le versant noir de l’affaire. La télévision reste l’emblème de
l’écroulement culturel avec son public captif vieillissant. Le personnel
politique parallèlement affiche des certitudes à mesure que son ignorance
croit, en confondant la notion de populaire avec celle de simpliste (la
génération « vu à la télé »). Les médias se copient les uns les
autres dans une image du public de plus en plus trash et nombriliste. Les
scientifiques se vendent à des firmes ou se mettent à faire du journalisme de
bas étage. Les créateurs se transforment en lobbyistes de PME cherchant à
épater les riches, à devenir des fonctionnaires culturels à vie ou à faire des
produits marketing mainstream.
Et pourtant. Et pourtant, il existe quelques
activistes rares du savoir et de la culture dans les télévisions (pas seulement
sur Arte). Des élus ont un réel intérêt pour la création en marche et une
connaissance ancrée du passé. Des journalistes se battent pour fournir des
repères honnêtes et défendre des réflexions critiques. Des scientifiques
restent à jamais dans l’ombre pour maintenir la rigueur de leurs recherches
malgré le pillage sans citation de leurs collègues ou leur mépris. Des
créateurs de toutes générations continuent dans un quasi anonymat et souvent de
micro-publics leur voie singulière.
Alors, la Résistance des savoirs ne doit pas être
celle d’une corporation contre une autre. Elle traverse les générations, comme
elle traverse les opinions, comme elle traverse les spécialités. La
responsabilité de l’écroulement est collective. L’énergie du redressement doit
être collective. Elle nécessite comme préliminaire de sérier les notions de
déculturation et d’acculturation. Si la notion de culture est cantonnée à la
musique dite « classique » et celle de savoir à la physique et aux
mathématiques, l’affaire est définitivement perdue. « Cultures de tous,
cultures pour tous » constitue le seul axe possible pour la transformation
des points de vue. Cultures de tous, car –sans pour autant les
mélanger—désormais les individus aux identités imbriquées que nous sommes
reçoivent simultanément des jeux vidéos ou la Joconde devenue image. Ouvrir à
ces formes culturelles variées (de la gastronomie à la photographie, de la
musique dite « classique » à la bande dessinée…) n’est pas les
confondre mais affirmer la légitimité et les spécificités de chacune.
« Cultures pour tous » induit d’avoir le
véritable souci d’une diffusion large pour tous les publics. C’est là
qu’intervient la volonté d’un mélange des consommateurs-acteurs. Il importe
pour cela d’abord de sortir d’une vision à la Guy Debord –celle de l’ère
télévisuelle—des spectateurs-consommateurs passifs. Au temps d’Internet,
beaucoup de consommateurs sont également des acteurs, des acteurs de millions
de micro-initiatives, des acteurs d’ailleurs aussi par leurs choix de
consommation, ce qui fait vivre par exemple ces petites scènes dites
alternatives. Ne craignons plus parallèlement la défense de micro-traditions ou
savoir-faire, à partir du moment où la démarche est choisie dans un esprit de
tri rétrofuturo (ce qui est gardé et là où il faut innover). Ce n’est pas du
poujadisme réactionnaire mais la base d’une structure de petits pôles d’excellence
en réseaux.
Ainsi, la mise en valeur dans des plateformes
régionales et nationales (pour un indispensable retour au local),
manière de revivifier la démocratie de proximité, est le seul moyen d’agréger
les énergies et de redonner le sentiment d’avoir prise sur son quotidien. Les
élus –harcelés par les quémandeurs et les lobbys de toute sorte—comme les
technocrates, formés à la dimension macro de l’économie ou de l’administration,
ont peur des citoyens qu’ils ne considèrent que comme source de revendications.
Ce faisant, ils passent à côté des énergies créatrices dans tous les domaines,
des PME à toute cette économie de la gratuité rassemblant les générations.
De surcroît, par un de ces étranges paradoxes, les
applicateurs, les techniciens ont pris le pouvoir --quand bien même ils se
trompent et se contredisent, sans être publiquement décrédibilisés--, alors que
les stratèges (visionnaires politiques, philosophiques, scientifiques) sont
relégués au placard et montrés comme de doux illuminés (quand l’invisibilité
totale n’est pas leur lot). Avec la sondagite et l’électoralisme démagogique
lié au news market, la tactique prime sur la stratégie pour des
objectifs fondés sur des intérêts à courte vue. Les deux catégories sont
pourtant utiles à la société, mais dans un rapport d’autorité inverse : la
stratégie détermine les tactiques.
Dans ce même souci de travail de fond, contre
l’acculturation et la déculturation, il importe bien sûr également d’insister
sur l’éducation à tout âge. Nous ne reviendrons pas sur la boussole éducative,
celle à laquelle chaque société devrait réfléchir. Mais il faut prioritairement
que tout le monde sache identifier ce qu’il voit. Face au maelström
déqualifié du tout et n’importe quoi sur nos écrans, le besoin de repères
devient essentiel. Voilà la tâche primordiale désormais sur ce terrain :
apporter des éléments de compréhension de notre environnement local et global
dans le temps et dans l’espace ; donner de la visibilité aux savants et
aux créateurs. Les médias ont commencé la première tâche, timidement. Mais le
besoin de savoir est immense, d’un savoir critique et d’un savoir puisé auprès
des chercheurs de terrain, pas des vulgarisateurs n’ayant pas ou plus fait de
recherche depuis des années.
Et puis il faut les valoriser, les montrer, qu’ils
redeviennent un modèle social. Pour la France, nous avions Pasteur et Victor
Hugo, stars à la fin du XIXe siècle. Ce n’est pas si mal. Mettons donc en
pleine lumière les Annette Messager et les Michel Pastoureau. Ils ont autant de
mérite que Zidane ou Johnny Halliday, Jean-François Copé et PPDA.
Repères et visibilité. Crédibilité aussi. La science
est expérimentale, critique, évolutive dans ses savoirs, fondée sur la
recherche. Les créations évoluent dans le temps et sont marquées par des modes.
La Résistance des savoirs consiste à pouvoir continuer de mettre en exergue
l’exigence et l’excellence du moment dans tous les domaines, du rap aux
mathématiques. Cela conduit à veiller à l’indépendance politique et commerciale
des chercheurs comme à celle des créateurs, à travers des structures de
référence qui évoluent, pouvant marier spécialistes et béotiens tirés au sort.
Désormais les sciences sont souvent en plein dans les débats sociaux, les
créations ont des incidences multiples sur la vie quotidienne. Il n’est plus
question de les laisser dans des micro-cercles opaques. Il faut ouvrir tout en
permettant l’excellence.
Voilà pourquoi nous appelons à une Résistance des
savoirs (et des savoir-faire). En dehors de l’élaboration de principes moraux
terriens évolutifs acceptés partout –enjeu central pointé dès 2000--, la
seconde grande question à venir sera bien celle de sciences indépendantes et
mises en valeur avec des créations défendant la diversité tant des supports que
des genres et des formes. Un enjeu éducatif, social, politique. C’est ainsi que
nous lutterons partout contre la déculturation d’une société uniforme moyenne
de consommation addictive et l’acculturation d’habitants qui, au nom d’une
prétendue « modernité », sont sommés d’abandonner en bloc leurs
traditions et leurs modes de pensée. La Résistance des savoirs est un éloge de
la diversité et de la liberté.
|
| 25 : 09 : 12 |

La vérité et ses soeurs cachées / Résistance des savoirs |
Bruno Latour avait bien voulu participer au Dictionnaire mondial des images. J'avais vu certaines de ses expositions réalisées au ZKM de Karlsruhe avec Peter Weibel. C'est un esprit fécond et indépendant.
Je suis devant son dernier ouvrage Enquête sur les modes d'existence, dont le titre évoquerait une sociologie traditionnelle et qui ne l'est pas. Cet ouvrage riche mérite davantage que quelques lignes jetées hâtivement. Il se présente comme une série d'ouvertures métaphysiques (et malicieuses aussi) destinées à être continuées sur Internet. J'avais moi-même proposé une telle aventure en 2002 pour la Philosophie de la relativité : un livre sans fin, à prolongements sur la Toile par échanges.
Voilà d'ailleurs --en creux-- une leçon pour les politiques au XXIe siècle. Ils apparaissent menteurs et impuissants, manipulés par des forces qui les dominent (l'argent et les médias) sur une planète désorganisée. Ces crises à répétition sont pourtant l'occasion pour eux de se ressourcer. Ils doivent revenir au local, repartir du local, réenchanter la citoyenneté de proximité. Paradoxalement les élus rejoignent les bureaucrates des administrations centrales : ils pensent que les décisions ne peuvent venir que d'en haut et ne croient qu'à la macroéconomie. Harcelés quotidiennement par des milliers de solliciteurs et de lobbies, leur vision de la population est déformée. Il faut encourager les micro-économies, le tissu des économies de la gratuité, la volonté de toutes générations de faire de l'engagement social et n'avoir pas peur de référendums locaux en ligne : que chacune et chacun comprenne son pouvoir et sa responsabilité sur ce qui l'entoure, sur ce qu'on garde et ce qu'on supprime, sur des savoir-faire et des traditions à préserver et la force d'invention et d'innovation.
Mais revenons à Bruno Latour. Je voudrais insister sur quelques aspects de son riche essai : d'abord, à travers son "anthropologie des Modernes", il appréhende à la fois l'échec de cette modernité rationaliste liée au Progrès et à la construction de sociétés idéales, tout en ne se satisfaisant pas d'un tel état dépressif intéressé (pour les puissants et les possédants), celui du relativisme, du post-modernisme où tout se vaut et rien ne vaut rien. Sa redéfinition du Moderne est une manière de relancer le mouvement et l'histoire, tout ce que beaucoup dans ma génération ne cesse de marteler contre l'escroquerie d'une fin de l'histoire ou d'une impuissance à transformer le social quand le commercial pollue la planète entière matériellement et culturellement.
La 'Pataphysique est la science des solutions imaginaires postulait Alfred Jarry. S'il n'est plus une Vérité, ce n'est pas que la démarche expérimentale, critique, de la science cesse d'être une façon utile d'organiser les rapports sociaux et sa vision du monde. La relativité est une manière rationnelle de comprendre la pluralité de regards et de solutions. Voilà notre nouvelle dynamique, seule capable d'offrir des passerelles entre des civilisations qui se respectent et une conception aventureuse, dans le mouvement perpétuel, de notre être au monde. Elle utilise la raison et l'imaginaire. Elle est rationnelle et tolère des approches différentes. Elle conçoit des règles évolutives acceptées partout pour notre survie planétaire et des comportements individuels divers, des micro-économies, la variété des modes de pensée dans un rapport local-global, des identités imbriquées, une vie politique et une histoire stratifiées.
Ainsi, science et poésie s'interpénètrent et se respectent. Raison et intuition se complètent. A nous de toujours bousculer le réel avec la conscience de notre implication dans l'environnement et de ses interactions innombrables. Merci Bruno Latour de nous inciter à repenser.
PS Encore quelques réflexions sur ma marotte, la déformation médiatique. Le journal Le Monde a consacré deux fois 2 pages au livre de Bruno Latour (ce qui est à souligner, car méritoire et exceptionnel dans le système actuel d'obsolescence du "visible"), Latour qui a parlé aussi sur France Inter. France Inter où j'ai pu d'ailleurs proférer quelques idées chez Stéphane Paoli sur les musées du XXIe siècle dimanche 23 septembre de 13h30 à 14h. France Inter qui fait un effort notable (Mathieu Vidard et d'autres) pour inviter quelques scientifiques et leur donner davantage d'audience. Mais leur visibilité ? Lorsque j'ai entendu le sommaire de la nouvelle émission culturelle de France 2 en seconde partie de soirée intitulée à dessein "Grand public", j'ai éteint : un florilège de "people" passant déjà en boucle sur toutes les chaînes. Ce n'est plus un panachage entre personnes connues et inconnues, c'est le martèlement des mêmes partout. Le divertissement fait office de culture. "Pas vu à la télé !" devient un nouveau label de dignité. Ainsi, le service public télévisuel coûte cher (France Télévisions) et il ne remplit nullement sa mission. L'acculturation généralisée opère qui va diviser la société entre une grande majorité (dirigeants compris) acculturée et des lumpenintellektuellen, rassemblant des savants et des créateurs de toutes générations n'ayant pas basculé dans le journalisme de plus bas étage. Le plus grave est que moins on est cultivé, plus on profère des certitudes sur tout. Il va falloir organiser la Résistance des savoirs en rassemblant les politiques qui continuent à croire aux valeurs de la connaissance, les journalistes pour qui vulgarisation est un terme noble et exigence intellectuelle une condition de la liberté, savants et créateurs refusant d'entrer dans la soupe dévalorisée du n'importe quoi vendeur à coup de rires et d'image de marque.
|
| 25 : 09 : 12 |
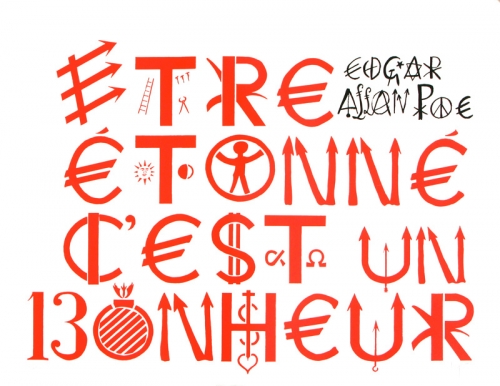
La boussole éducative |
Pourquoi les débats sur l’éducation ont-ils
tendance à partir en vrille sur des sujets périphériques ? Pour
convaincre, à force de chamailleries sémantiques, que le système en place est
impossible à réformer ? Ce devrait pourtant être l’occasion de réfléchir
sans barrières mentales aux contenus éducatifs et aux vecteurs de l’éducation à
l’heure d’Internet. Parlons des contenus. L’éducation, fonction aussi ancienne
que les humains, implantée solidement dans le monde animal, est le moyen
d’aider les enfants à connaître leur environnement et à choisir ensuite leurs
comportements. Cela peut être dévoyé en embrigadement des esprits pour limiter
leurs actions et leurs pensées. Cela devrait être un éloge du savoir et un
apprentissage de la liberté par le développement de l’esprit critique et du
doute scientifique.
Tous les pédagogues constatent –au moins
sont-ils à peu près d’accord sur ce point-- combien le premier âge est
important. Le ou les parents, la famille, les tuteurs éveillent à l’environnement
immédiat. Cela se passe dans toutes les civilisations et à l’heure d’homo relativus, de la relativité (qui
n’est pas le relativisme) et du nécessaire respect des façons de penser sur
divers continents, il serait idiot de nier le caractère indispensable de
l’apprentissage de la langue locale et de l’environnement local, chez les
Wayanas en forêt amazonienne ou en pays dogon. La connaissance fine des plantes
et animaux dans la forêt est plus importante que la maîtrise des mathématiques
en certains endroits. Cessons donc d’acculturer.
Il existe néanmoins un second étage de
connaissances qui, adaptées à chaque lieu, apportent des repères scientifiques
sur notre humaine condition : c’est ce que nous pourrions appeler la boussole éducative. Elle passe par la
maîtrise de sa langue locale mais aussi très tôt par celle d’une langue
internationale. Elle induit l’écriture, la lecture et le calcul. Mais aussi des
savoirs qui permettent de se situer dans le temps et dans l’espace et préparent
à la compréhension de son environnement.
Maîtriser les langues et la lecture ?
Certes. Pourtant, nos enfants sont-ils aujourd’hui seulement en contact avec de
l’écrit et de l’oral ? Bien sûr que non. Ils sont environnés d’images
fixes et mobiles de toutes sortes. Sans aucun repère. Il est temps, largement au-delà
de cette seule notion occidentale d’ « art », de leur apprendre
l’histoire générale de la production visuelle humaine, dans laquelle les arts
sont intégrés, mais qui identifie la diversité des supports, des continents et
leur histoire et décrypte ainsi l’actuelle accumulation médiatique généralisée.
Ne pas le faire ou le faire partiellement serait exactement comme jadis, à
l’heure de la diffusion massive du livre, refuser d’enseigner la lecture ou
n’apprendre que la lecture de la poésie. Ces repères s’accompagnent bien sûr d’initiations
aux pratiques culturelles.
Parallèlement, l’histoire générale de notre
planète fournit à chacune et à chacun des éléments de base de chronologie.
Cette histoire s’impose de manière stratifiée
aujourd’hui, partant de l’histoire locale –indispensable à Nevers comme à
Ouagadougou—pour aller vers l’histoire nationale, continentale et planétaire.
La chronologie forme ainsi un repère mental de base à l’heure de l’accumulation
indifférenciée du tout-écran. La géographie, parallèlement, permet de
comprendre l’espace et son évolution. Elle doit se combiner avec l’étude des
mutations de l’environnement.
Cependant notre environnement est aussi
sonore. L’histoire générale des musiques apporte alors des repères
indispensables, partant de traditions locales jusqu’à la diversité des formes
internationalisées aujourd’hui. Là encore, un équilibre doit être trouvé entre
l’apprentissage de savoirs chronologiques et thématiques et une part d’initiation
culturelle et de pratiques personnelles.
Cela conduit à l’éducation du corps et des
sens. La gymnastique certes et les différents sports mais aussi la danse.
L’éveil du goût et de l’odorat dans des cantines variant les aliments et
initiant à des cuisines diverses. Et, nous l’avons abordé, une éducation
culturelle large (spectacle vivant, expressions plastiques avec images fixes et
mobiles, musique, gastronomie…) qui permette des initiations aux techniques de
création et aux gestes créateurs (avec des créateurs), tout en ouvrant aux
pratiques culturelles (théâtres, cinémas, musées…).
Ce programme de base sera évidemment enrichi,
l’âge venant, à l’histoire des religions et des philosophies (base d’un code de
valeurs universelles), aux théories économiques ou aux sciences de
l’environnement. Enjeu fondamental quand les sociétés humaines affrontent
l’égalité des chances comme condition de leur épanouissement, de leur
innovation et de leur créativité.
Il est donc temps de cesser de partir de
l’existant pour envisager quelques aménagements concertés à minima, mais, au contraire, définir des apprentissages essentiels
et voir comment leur mise en œuvre peut être opérée en différentes étapes par
l’outil éducatif. Cette vision stratégique permettra aux enseignants sur le
terrain --dont on ne soulignera jamais suffisamment la difficulté de la tâche
dans la société d’aujourd’hui—de cesser d’être ballotés de réformette en
réformette pour comprendre vers quoi ils vont et pourquoi ils le font. Si nous
voulons que l’éléphant accouche d’un éléphant et pas d’une souris, posons les
bonnes questions de base et cessons de prendre le problème à l’envers.
|
| 05 : 09 : 12 |

Homo relativus contre homo economicus |
Daniel Cohen publie le livre Homo economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux. Une ironie facile ferait remarquer qu'enfin les économistes découvrent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais le livre mérite d'aller plus loin dans la réflexion. D'abord, cette notion de "bonheur", comme celle de "paradis", sont des notions tout à fait inhumaines. Elles ont accompagné les pires dictatures et les illusions dangereuses de fin de l'histoire par l'établissement d'une société parfaite arrêtée. Il vaudrait mieux parler de plaisirs et de bien-être.
De même, il est temps d'arrêter de parler de "progrès", résultat d'une pensée occidentale scientiste. Ce n'est pas parce que nos connaissances augmentent dans certains domaines ou que la technologie se développe dans d'autres ou que la longévité physique augmente que les individus ont un meilleur bien-être en adéquation avec l'environnement. Là aussi, il vaudrait mieux parler de mouvement nécessaire, d'évolution, de perfectionnements, de recherches personnelles et sociales. Il est temps en effet de sortir de l'idée erronée que la multiplication des biens matériels ou la durée de vie sont de facto des "progrès". Voilà un des mérites du livre cité : montrer que nos sociétés économiques ne sont pas des sociétés du mieux être et, par voie de conséquence, que la notion de pauvreté est une notion relative (est plus pauvre une personne acculturée et pensionnée par rapport à une autre sans aucun revenu monétaire mais intégrée à un système social proche qui la protège).
Il importe d'adopter désormais un point de vue post-colonial. Nous devons accepter des modes de vie et des conceptions du monde variés, venant de continents et de civilisations divers. Nous devons entrer dans une ère expérimentale où les modèles sont multiples. Nous avons aussi à apprendre des sociétés nomades sans argent. J'avais écrit en 2000 "Le XXIe siècle sera moral", c'est bien cela qui nous occupe : le choix de nos valeurs. Et nous nous apercevons de l'importance des échanges non-monétaires (surtout à l'ère d'Internet, sur le réseau mais aussi autour de soi) et des économies de la gratuité, jamais mesurées car difficilement mesurables mais qui font "tenir" des peuples entiers de façon incompréhensible de l'extérieur.
Ainsi homo relativus lutte contre homo pyramidalibus et homo economicus. En effet, après la longue ère nomade, avec les néolithiques ont été bâties les villes et des sociétés autoritaires pyramidales avec pouvoir sacré et profane. Cela n'a pas cessé et est encore en place dans beaucoup d'endroits ou hante la pensée de beaucoup de groupes : j'ai appelé cela les "monoretros", ayant une conception figée du monde et exclusive bâtie dans le passé. Ils côtoient l'homo economicus, cet être acculturé envahi de produits industriels diffusés massivement, n'ayant aucun pouvoir de décision au niveau local, soumis à la globalisation monétaire de la planète et obéissant à l'extérieur, au lointain parfois indéfini, dans son travail et sa consommation. Autre forme de servilité.
Dans une telle situation, les gouvernements --notamment socialiste en France aujourd'hui-- ont une chance unique de réveiller les bonnes volontés locales. Au lieu d'avoir peur du peuple, il est temps de célébrer homo relativus, cet être du local-global au temps d'Internet, capable de s'exprimer directement sur le réseau et d'intervenir dans son champ local. L'actuelle conjugaison des générations est d'ailleurs une opportunité dans les sociétés de vie plus longue : des jeunes à la première vieillesse, il existe beaucoup d'interventions citoyennes économiques et/ou culturelles. Réveiller et valoriser les initiatives locales dans des portails régionaux, nationaux et à l'export constitue la chance en temps de crise de bouger la société aujourd'hui, d'encourager l'économie de la gratuité, de favoriser le développement des PME et tout le tissu local. Ne la laissons pas passer.
De toute façon, la mise en avant du local-global et d'homo relativus sous-entend de cesser de penser uniformiser la planète dans un modèle politique parfait --ou le moins mauvais possible sous une idéologie du "moyen"-- avec des règles sociales intangibles et des comportements individuels standardisés. S'obnubiler de la macro-économie oblige à s'enfermer dans des paramètres très partiels, des mesures très ciblées, et ignore les ressources des micro-économies. Se bloquer sur une conception idéologique (religieuse ou profane) figée de l'organisation sociale est illusoire sur la durée et dangereux : lutter pour le "mieux" oui, faire croire à un état de bonheur terrestre atteint et irréversible, sûrement non, même comme objectif. Promettre le mieux-être, oui, pas le bonheur ! Décidément et au contraire, si une morale minimale évolutive est nécessaire et une conscience des enjeux de survie collective (dont des règles d'économie générale), ce sont bien les expérimentations de vie sociale et la diversité des comportements individuels qui permettront de poursuivre l'aventure humaine planétaire. En tout cas, pas une seule solution politique, une seule vision du monde, un seul modèle économique. Expérimentons.
Petit résumé :
L'humain
relatif (homo relativus) est celui qui agit dans le local-global (directement autour de lui et par le Net), qui conçoit la
relativité des points de vue et des civilisations, qui combine ses
identités imbriquées et évolutives, qui connait nos histoires stratifiées
et nos choix rétro-futuro. Il s'oppose à l'humain pyramidal (homo pyramidalibus) des sociétés
autoritaires, religieuses ou profanes, mises en place depuis les Néolithiques (idéologies monorétro). Il s'oppose aussi à l'humain
économique (homo economicus), ce consommateur standardisé passif, ce clone médicalisé des
sociétés dépressives de l'insatisfaction et de l'addiction dans la mondialisation des produits.
|
| 12 : 07 : 12 |
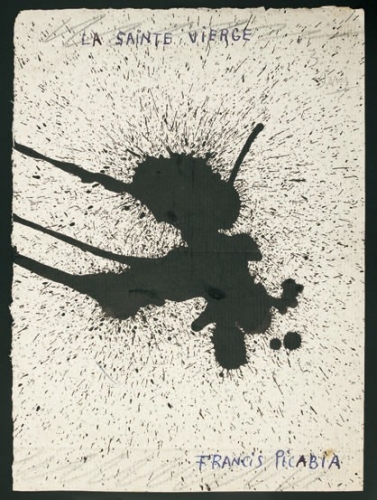
Respirer : un peu d'art frais ! |
Non, les ardeurs estivales d'un soleil absent ne me découragent pas pour achever un 7e long-métrage avec la complicité de Jean-Hugues Berrou et Emmanuel Chirache. J'en donne le résumé plus bas. Il est consacré à Noël Arnaud que personne --ou presque-- ne connaît. Et pourtant, Noël fait le lien entre Dada, le surréalisme de résistance sous l'Occupation, Cobra, les situationnistes, l'art et la vie. Personnage secret.
Dans notre monde de marketing documentaire, où il faut vendre ses sujets, ce film est résolument sans espoir. Pourtant, les colères saines de cet homme sont là pour continuer à inspirer une jeunesse qui ne doit jamais se résoudre à l'absurde et à l'injuste. Le rire, la parodie 'pataphysique, l'imaginaire au quotidien, renverseront toujours les dictatures et le formol de nos hospitalisations physiques et mentales au quotidien. Haïssez les médecins et mourrez heureux !
------------------------------------------------------------------------------------
POLITICALLY INKORECT !
Noël Arnaud
et Dada, Jarry, Picasso, Jorn, Duchamp, Debord, Vian, l'Oulipo...
Un film de Laurent Gervereau avec la complicité de Jean-Hugues Berrou et Emmanuel Chirache
Histoire d'un invisible : voilà le chaînon manquant --et longtemps caché-- entre Dada et les
situationnistes ou Fluxus, en passant par le surréalisme clandestin
pendant la guerre et Cobra. Il s'agit du seul film où cet homme secret
parle de son parcours incroyable, à la fois acteur et passeur des
avant-gardes, ayant côtoyé tous les personnages essentiels cherchant à
changer la vie, à sortir des frontières de la peinture de chevalet,
bousculant la littérature. Entre jazz, dérives, toiles provocations,
fêtes-happenings, rires et absurde, une existence-oeuvre d'art totale.
Y
sont insérés : un entretien inédit de Constant sur Cobra et les débuts
de l'Internationale situationniste avec New Babylon ; un long et
précieux extrait sonore de la conférence de Guy Debord avec Noël Arnaud en 1957.
|
| 25 : 05 : 12 |

Québec et Rio : encore la JUSTICE ! JUST DU ! |
Cela fait des mois que nos amis québécois, avec Pierre, nous alertent sur l'incroyable soulèvement de la dignité des étudiants. L'accumulation des mesures obscurantistes depuis des années a bloqué soudain sur le relèvement des tarifs à l'université. C'est un combat qui occupe en fait la planète : arrêter de favoriser les intérêts temporaires de quelques-uns pour prendre en compte les intérêts durables de tous. Cette question basique de JUSTICE est aussi une question de DURABILITE, quand certains s'octroient le droit de polluer et de détruire physiquement et culturellement des régions entières pour des intérêts à court terme, quand des politiques se voilent volontairement la face sur ce qui se passera dans 5, 10 ou 20 ans.
Nous sommes sur le même navire, avec les même enjeux que les Québécois (ou d'autres). Justice et durabilité ? Il y avait "just do it", nous entendons déjà des JUST DU !
Post Scriptum : Nous entendons parler de plus en plus ces temps-ci de "social-écologie".
Tant mieux, car cela fait des années que j'affirme les enjeux de
justice et de durabilité comme centraux (www.see-socioecolo.com). Il est
indispensable de lier ces courants de pensée et de bâtir de grands
mouvements sociaux-écologistes dans le monde. Quand, philosophiquement,
ces organisations auront intégré la dimension évolutionniste (le choix
du mouvement avec le refus de l'illusion d'une société parfaite) et le
principe de relativité (la défense de la diversité et le rejet d'une
société normée), nous aurons avancé dans une confrontation
des idées toujours à mener. Cela permettra de disposer d'une vraie
pensée du futur, de valeurs communes, au lieu de laisser le terrain aux
néoréactionnaires et à la copie peureuse d'un passé mythifié
(c'est-à-dire tel qu'il n'a jamais existé, en en oubliant toutes les
horreurs et les tares). Ajoutons qu'à l'ère d'Internet, les
technocraties vont vite s'apercevoir qu'il n'est plus possible de
décider sans associer les populations. C'est donc à un réveil du local
dans un dialogue global que nous allons assister, sur fond de
crise de confiance généralisée. Soit la fermeture des frontières et le repli sur le passé, soit l'évolution et la solidarité planétaire.
A Rio ou ailleurs, le court-termisme est notre ennemi, il est lâche et souvent criminel. Ici, c'est dans une indifférence générale que nous apprenons la caractère cancérigène des moteurs diesels, tandis que nous subissons --sûrement pour des raisons croisées-- une épidémie de cancers. Ma mère meurt après s'être longuement ou brutalement dégradée. Partout, autour de nous, la mort lente nous accompagne.
|
| 06 : 05 : 12 |

Défaite du nationalisme, victoire de la République ! |
Allez sur lemonde.fr lire l'article :
http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/05/11/defaite-du-nationalisme-victoire-de-la-republique_1699466_3232.html
Il
est important désormais de ne pas laisser le champ libre aux
néoréactionnaires mais de proposer de nouveaux regards et de nouveaux
repères dans une vision rassembleuse et pragmatique du futur.
L'histoire se fait chaque jour et nous en sommes responsables. Ne gâchons pas la chance qui s'ouvre. Bâtissons durable.
Contre les néoréactionnaires, repensons avec pragmatisme le futur !
|
| 21 : 04 : 12 |

UNE ELECTION, ET APRES ? |
Soutenez CULTURES DE TOUS, CULTURES POUR TOUS ! sur la page Facebook de l'INSTITUT DES IMAGES, de manière à réveiller créations et partages des savoirs, sans retomber dans les paillettes éphémères, mais en valorisant durablement les initiatives de terrain. Pas une question de fric : nos crises sont des ruptures de modèles nécessaires !
Et n'oublions pas que nous sommes face à l'histoire pour la formation des citoyennes et des citoyens : IGNORER L'HISTOIRE ET L'ANALYSE DU VISUEL A TOUS LES AGES AUJOURD'HUI, CE SERAIT COMME REFUSER JADIS D'ENSEIGNER L'ECRIT AU TEMPS DE LA REVOLUTION DU LIVRE.
|
| 10 : 04 : 12 |
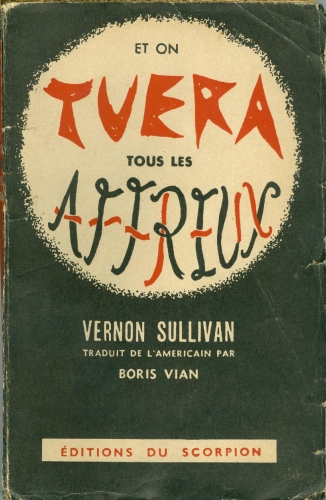
Sous une campagne de cache-cache... |
Cet article est paru dans le journal Libération du 17 avril 2012 . A la suite de cela est né un intéressant débat sur la blogosphère. Soyons clairs pour que chacun juge. Ma position a toujours été celle de la défense d'Internet comme espace de liberté. Je me méfie de toutes les censures larvées sous prétexte de bonnes intentions et ce n'est pas par hasard que le masque des "anonymous" apparaît dans les "unes" de ce site. Alors il nous faut constater que la réactivité à la moindre annonce des cellules de riposte a limité la campagne électorale actuelle à des annonces-slogans et des non-programmes frileux. C'est l'effet tweet asphyxiant. En revanche, le développement de la blogosphère est l'amorce pour moi du passage d'une société du spectacle à des sociétés de spectateurs-acteurs. J'aimerais que les transformations profondes de la société et de nos regards sur le monde entrent encore davantage dans les sujets quotidiens. Merci de préciser et de lire les livres présentés sur ce site ("idées..." et "livres"). Voici l'article en question :
Pourquoi la campagne électorale française de 2012
apparaît-elle comme aussi longue et aussi ennuyeuse ? Parce que chaque
électrice et chaque électeur sent bien que tout se joue de façon masquée. Nous
voici dans une campagne-twitter. Il y avait avec Lénine l’agit-prop
(agitation-propagande), voici l’ère de la piqûre de moustique : la tweet-prop. Cette réactivité compulsive
des cellules de riposte et des bloggeurs suractifs ne donne plus le temps pour
les réflexions de fond. Il vaut mieux avancer masqué en martelant un ou deux slogans pour parler à la tribune ou sur les écrans, car la politique, c’est le verbe.
L’ensemble de la population a de toute façon intégré le fait
que la dette d’Etat plombe les marges de manoeuvre. Donc les enthousiasmes sont
vite refroidis, même chez les plus bravaches. Pourtant, comme toujours, il
existe des surprises. Jadis (2002), la surprise tint dans le kidnapping
thématique de la campagne par la « sécurité ». Ensuite, ce fut le
débordement de la « peoplisation » (Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal
s’imposant dans leur camp en s’étalant dans les magazines), provoquant, par
contrecoup, l’émergence Bayrou. Aujourd’hui, la caractéristique est la volonté
de rupture par rapport aux années Sarkozy vues comme les années de la finance
triomphante, de la destruction de l’économie réelle et du vivre ensemble avec
des injustices grandissantes. Cette rupture est affirmée partout, même par un
candidat-Président voué à une schizophrénie qui ne lui déplaît pas, car il
s’est montré l’apôtre de la réactivité immédiate (au risque assumé de se
contredire).
Du coup, la « surprise » 2012 est Jean-Luc Mélenchon,
car il est le meilleur tribun de la rupture avec le capitalisme financier. Son
discours, de plus –et cela a été peu souligné—, est novateur par rapport à ceux
traditionnels de la famille communiste. Il intègre ainsi la nécessité de
s’inscrire dans une logique « verte » ; il ne tient pas la ligne
nationaliste de la fermeture des frontières mais parle d’Europe, d’Europe
transformée, et de mondialisation, d’échanges, de migrations positives. Le
peuple français, à travers cette élection, commence en fait à comprendre que
nous ne vivons pas des « crises » mais des ruptures de modèles. Cela
brouille les lignes dans chaque camp : traditionalistes contre
innovateurs.
Marine Le Pen a pris ainsi un tournant social qui était
étranger à son père, même si l'offensive sarkozyenne l'oblige à revenir à ses fondamentaux. Le candidat-président tente, lui, à nouveau d’apparaître
comme le rassembleur de la droite nationale et de la droite réformiste.
François Bayrou peine à renouveler un simple discours du « ni-ni »,
ayant laissé échapper la chance de fédérer droite réformiste et gauche modérée.
François Hollande tient sa seule ligne possible, mais du coup sans indiquer qui
triomphera au pouvoir : les gestionnaires productivistes ou les promoteurs
de nouvelles formes démocratiques durables. Jean-Luc Mélenchon unit des
bureaucrates bien peu démocrates et des penseurs d’une économie durable (des
libertaires proudhoniens environnementalistes), grand écart aussi, qu’il lie
grâce à un verbe républicain. Enfin, Eva Joly peine à additionner moralisation
de la vie publique avec un véritable aggiornamento écologiste.
Si la justice a explosé comme thème central, l’écologie est en
effet le non-dit assourdissant de cette campagne : comme si chacun voulait une
rémission avant d’entrer dans cette perspective inévitable, comme si les
catastrophes environnementales et les acculturations ne touchaient pas d’abord
les plus pauvres. La crise financière est brandie, la crise environnementale est
tue.
Cela s’explique par une lutte dans tous les camps entre conservateurs
et rénovateurs. Alors, paradoxalement, cette élection masquée et frustrante se
révèlera probablement dans l’Histoire comme une élection-tournant : la
majorité des Français –cela traverse la pyramide des âges-- se rend bien compte
des insatisfactions dépressives induites par les comportements de consommation
addictive, par l’aberration d’une société qui a rendu ses savants invisibles au
profit des bateleurs, par un besoin de valeurs face au tout-argent.
La vraie question aujourd’hui, dans ce cache-cache,
reste : que va faire effectivement le futur gouvernement ? La crainte
que nous pouvons avoir est que les difficultés financières paralysent les
dirigeants dans des logiques surannées. L’heure en effet n’est plus aux
paillettes. Ni aux blocages administratifs d’ailleurs. Ni à la simple gestion. Il
est temps de secouer le système par le bas pour redonner espoir sur les
questions de justice et de durabilité (les socioécologistes sont nés de ces
deux nécessités). La refondation de la démocratie est indispensable en passant
de la société du spectacle aux sociétés des spectateurs-acteurs. C’est par ce
retour au local que va s’organiser le « remue-méninge » nécessaire
partout sur les manières dont nous voulons vivre, l’aspect rétro-futuro :
ce qu’on souhaite conserver et là où il faut innover. Traditions choisies et
transformations.
Tout cela s’inscrit dans des pensées locales-globales, de
prises en mains par chacune et chacun de son univers visible direct, par des mécanismes
rapides d’expérimentations in situ, par des choix de consommateurs-acteurs qui
défendent des productions locales, et une ouverture par pallier vers la
planète. A l’Etat national de devenir ainsi un dynamiseur, un agent de
structuration de pôles d’excellence en réseaux et d’aide à la diffusion
planétaire. Le local-global, à l’ère d’Internet, est notre nouvelle échelle
obligée, celle de nos identités imbriquées et des responsabilités stratifiées.
Alors, gageons que cette élection ennuyeuse va se révéler plus
significative qu’on ne pourrait le penser. Le malaise général est éloquent et
le sentiment de paralysie devient insupportable. La véritable question sera
ensuite de savoir si le futur gouvernement saura rassembler et dynamiser par la
mise en valeur du local et une structuration prenant en compte les mutations
environnementales et culturelles en cours ou si –par cécité ou paresse—la seule
mise à jour des comptes va désespérer un peu plus un peuple sans idéal, sans
modèle, sans allant. Ce n’est nullement une question d’argent.
Message des socioécologistes :
Ce texte de Laurent Gervereau pose les bases des transformations à venir, que nous avons initiées au Brésil et au Canada. Beaucoup surnomment désormais le personnage avec une ironie tendre : "le plus gros iceberg du XXIe siècle". Il est stupéfiant en effet d'avoir travaillé pendant 30 ans dans l'ombre sur le monde nouveau des images, la philosophie de la relativité, les humains planétaires et leurs identités imbriquées, l'écologie culturelle, la fracture générationnelle, la traversée des utopies, sans que ces idées n'aient été massivement visibles, même pour être contestées. Comme le dit paradoxalement Michel Serres (Le Monde du 13 avril 2012) à 82 ans, il est temps de penser autrement que les "vieux pépés" de la sinistrose occupant les écrans depuis les années 1970 en s'étant toujours trompés et en interdisant de façon scandaleuse toute innovation ou toute expérimentation au nom de leurs échecs.
L'heure est venue, avec notamment les socioécologistes (voir www.see-socioecolo.com et la rubrique "idées, philo, politique" de gervereau.com), de regarder sous le niveau de l'eau et de diffuser enfin massivement des perspectives nouvelles.
|
| 31 : 03 : 12 |

CULTURES DE TOUS, CULTURES POUR TOUS |
Cultures de
tous, cultures pour
tous
En ouverture de ce texte qui cherche à permettre les conditions d'une vraie éducation culturelle pérenne et utile, je veux avoir une forte pensée pour Aminata Traoré, Samuel Sidibé et tous les amis du Mali, ce pays extraordinaire actuellement déchiré. Mon film "La pauvreté, c'est quoi ?", tourné entre Bamako-Ségou-Mopti-Sangha et le pays Dogon- Tombouctou et le Sahara-jusqu'à Kayes sur le fleuve Sénégal, totalement impossible à réaliser aujourd'hui, devient un document exceptionnel de peuples vivant en paix dans une incroyable diversité au nom d'une histoire très longue.
La culture tente de s’immiscer
comme thème de campagne électorale. Mais outre le fait qu’elle apparaît pour beaucoup
comme une « danseuse » en temps de crise, nous voyons combien le
débat est faussé par des lobbies défendant avant tout leurs subventions. Si
avoir une politique culturelle d’Etat consiste à dépenser 1% du budget général,
la belle affaire. Certains pays d’ailleurs n’ont pas de ministère de la Culture,
considérant que la culture est partout et du ressort de la société civile pour
en assurer la diversité.
En France, nous sentons qu’il est
temps d’une refondation à une époque de basculement générationnel et d’une
nouvelle donne technologique avec Internet. Quelques auteurs ont pointé avec
justesse plusieurs nouveaux enjeux. Sur le fond, Bernard Stiegler refuse à
juste titre un tri sélectif : des cultures « populaires » et
d’autres non, des publics cultivés et d’autres « éloignés de la culture ».
Olivier Poivre d’Arvor, lui, a identifié deux aspects essentiels qui sont
d’ailleurs liés entre eux : la révolution numérique et la question de
l’exportation culturelle.
Pour ce qui concerne la
définition de la notion de culture dans la société actuelle, il importe de
sortir d’une vision cloisonnée qui n’est plus de mise. Le sociologue Bernard
Lahire a bien montré l’hybridation des goûts et la capillarité des habitudes
culturelles. Ce n’est pas d’ailleurs que l’individu pense faire la même chose
en allant à un match de football ou en lisant un roman japonais. Posons les
choses clairement : la relativité des attitudes n’est nullement un
relativisme philosophique (tout se vaut, donc rien ne vaut rien). L’individu va
voir un tableau de Vermeer différemment de la manière dont il lit une bande
dessinée. Tout cela correspond de plus, dans notre monde d’aujourd’hui, à ce
que j’ai défini comme des identités imbriquées et une histoire stratifiée du
local au global. Nous vivons, non plus avec le High et le Low, la Culture et
des formes d’expression populaires, nous vivons dans un ensemble d’expressions
culturelles, dans un ensemble de cultures qui ont chacune une spécificité :
cultures de tous.
Voilà pour le constat. Mais que
faire ? Supprimer tout ministère et laisser prospérer ou dépérir ? Comment
justifier l’aide publique en temps d’argent rare pour l’Etat ou les
collectivités locales ? Souvent, seule l’argumentation d’une défense des
budgets fait office de politique culturelle. C’est court.
Le soutien aux industries et aux
métiers culturels est un aspect. La pensée d’un patrimoine conservé, valorisé
et facteur d’image est un autre. Mais tout cela doit se faire par une mise à
plat et des enquêtes du local au régional, du régional au national pour être
porté vers le continental et le global. L’Etat dialogue avec les collectivités,
il aide à une mise en réseau de pôles d’excellence sur tout le territoire.
C’est un vrai big-bang de la visibilité
locale qui s’impose. La question n’est pas alors financière, mais de
valorisation et de dynamisation du tissu des initiatives.
Dans quel but ? Que la
culture serve l’image, la visibilité locale pour porter notamment les
entreprises. Que les savoir-faire dans tous les domaines adoptent une attitude
« rétro-futuro » : préserver et innover. Que le tourisme soit
rattaché à la culture d’un côté et l’exportation culturelle de l’autre. On
comprendra ainsi qu’il existe une véritable économie culturelle d’une part et
que d’autre part des apports culturels intangibles, non financiers, non
mesurables, ont une importance primordiale.
Une culture pour porter l’économie
et faire image ? Certes. Mais à quoi bon en élargir la définition si c’est
pour s’adresser à des consommateurs addictifs, passifs. Le prochain
gouvernement sera donc aussi jugé sur une véritable démocratisation culturelle : cultures pour tous. Elle pourrait passer par la création d’un
ministère de l’Education et des Cultures en suivant le fil de la pensée de Jean
Zay. En tout cas, il est nécessaire de créer un Secrétariat d’Etat à
l’éducation culturelle (plutôt qu’une mission interministérielle qui risque de
se perdre dans les limbes administratives). Ce Secrétariat d’Etat aura pour
mission d’offrir les conditions de cette éducation tout au long de la vie
depuis la maternelle.
Du point de vue du contenu, il
importera d’abord d’initier aux pratiques culturelles : création,
techniques, consommation. Ces initiations seront aussi un éveil au sensible. Il
s’agit en second lieu d’inscrire durablement l’apprentissage de repères dans le
domaine visuel et musical.
L’histoire et l’analyse du visuel doivent en effet être enseignés
depuis la maternelle jusqu’à l’université et des modules ouverts à tout âge.
Pourquoi cette urgence singulière ? Nous basculons d’une civilisation dans
une autre. Jamais dans l’histoire de l’humanité nous n’avons été ainsi en
contact avec des images de toutes périodes, de toutes civilisations, sur tout
support, créant une ubiquité constante. Et nos enseignements n’en tiendraient
pas compte ? Nous raterions une étape primordiale (et serions obligés ensuite
de courir après d’autres pays dans quelques années). Nous raterions aussi
l’occasion de développer de la recherche et des produits exportables dans
ce domaine. Il s’agit donc d’un impératif citoyen urgent.
Comment alors faire avancer les
choses de façon décisive (nous avions eu de bonnes paroles de tous les
candidats en 2007, sans aucun résultat) ? Il faut créer ce Secrétariat
d’Etat pérenne. A charge pour lui de commencer par la base : l’inventaire
rapide de toutes les initiatives –souvent remarquables—disséminées sur le
territoire dans le domaine culturel et éducatif. A lui de les valoriser par des
plates-formes régionales et une plate-forme nationale. A lui de créer des pôles
d’excellence en réseau et des outils de formation des formateurs. A lui de
lancer le périmètre d’un établissement public nouveau à partir des ressources
existantes : Centre d’éducation culturelle, qui sera chargé d’animer cette
question de façon souple en liaison avec tout le réseau local et en ayant le
souci aussi de l’international. A lui d’aider France 5 à avoir enfin un rôle
éducatif et valoriser les créateurs et les savants totalement disparus des
modèles sociaux « visibles », ce qui pose une question morale et éducative
fondamentale. Le savoir doit redevenir une valeur dans la société.
Nous en avons assez des bonnes
paroles stériles, de l’argent public dépensé sans aucun effet, des initiatives
nombreuses toujours isolées et méprisées. Nous attendons des engagements clairs
dans ces trois domaines : visibilité des initiatives locales,
démocratisation culturelle, introduction à tous les âges de l’histoire et de
l’analyse du visuel.
Laurent Gervereau
Directeur de www.decryptimages.net avec la Ligue de
l’Enseignement,
plus important
portail d’éducation culturelle francophone
|
|